lundi, 22 décembre 2014
La «Grande Séparation»: du citoyen à l’homme de rien…

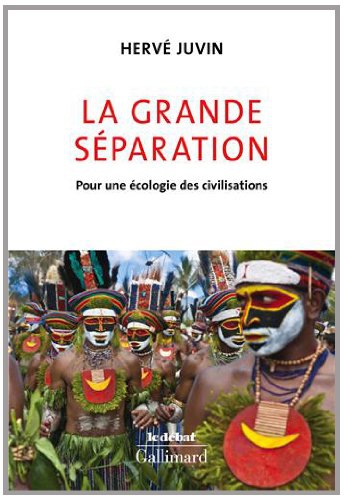 J’ai écrit La Grande Séparation parce que je suis affolé de la perte de notre mémoire historique qui accompagne la perte de notre identité nationale. Le monde dans lequel nous vivons encore est dessiné par des frontières, par des nations, qui nous donnent notre citoyenneté et notre identité. Le principe de la souveraineté nationale garantit aux citoyens la liberté de décider de leurs lois, de leurs mœurs, de leur destin, sur leur territoire et à l’intérieur de leurs frontières. Les conditions d’acquisition de la citoyenneté assurent l’unité de la nation, et la transmission entre les générations. La séparation est géographique, respectueuse des cultures, des civilisations, de la diversité collective des peuples.
J’ai écrit La Grande Séparation parce que je suis affolé de la perte de notre mémoire historique qui accompagne la perte de notre identité nationale. Le monde dans lequel nous vivons encore est dessiné par des frontières, par des nations, qui nous donnent notre citoyenneté et notre identité. Le principe de la souveraineté nationale garantit aux citoyens la liberté de décider de leurs lois, de leurs mœurs, de leur destin, sur leur territoire et à l’intérieur de leurs frontières. Les conditions d’acquisition de la citoyenneté assurent l’unité de la nation, et la transmission entre les générations. La séparation est géographique, respectueuse des cultures, des civilisations, de la diversité collective des peuples.
La Grande Séparation qui vient affirme que rien n’existe que l’individu absolu. Elle invente l’homme hors-sol, sans histoire, sans origine, sans sexe, sans âge, sans race. Elle nous sépare de nos territoires, de nos identités, de nos origines. Elle célèbre l’homme de nulle part, le migrant perpétuel, sans identité, sans appartenance et sans liens. Et elle nous coupe de l’histoire, elle célèbre le consommateur pour effacer le citoyen, elle laisse la propriété et le marché dévorer la nation et l’identité.
Des forces puissantes agissent en faveur de cette Grande Séparation. Les intérêts qui veulent remplacer la société par le contrat privé, le marché et l’individu de droit ne manquent pas. Ceux qui considèrent que la nation et l’État ne sont que des entraves à l’exploitation de toutes les ressources disponibles sur la planète non plus. Qui sont ces gens qui s’opposent à ce qu’on creuse leur sol pour y exploiter le gaz de schiste ? Qui sont ceux qui entendent préserver leurs espèces animales et végétales endémiques, quand les usines du vivant leur promettent de meilleurs rendements ? Et qui sont ces indigènes qui s’opposent aux colons qui tirent plus d’argent de leurs terres, de leurs mers et de leur vie ?
J’ai voulu contribuer à alerter les Français. Nous vivons un nouvel épisode de la colonisation. Ce sont les ONG, les fondations, les fonds d’investissement qui s’y emploient. Cette fois, c’est nous qui sommes victimes, comme ils l’ont été, eux du Congo, du Maroc ou de Chine. Mais la réalité n’a pas changé. Nous vivons aussi un nouvel épisode de la guerre de toujours, celle de la liberté des peuples à décider de leur destin. Cette fois, des États-Unis dont l’autorité morale est ruinée, dont la prétention à détenir le secret de la réussite est épuisée, et qui n’ont plus que leur force militaire pour écraser le monde, constituent la première menace pour la paix mondiale et pour notre liberté. Mais ne nous y trompons pas. La religion scientiste, l’idée folle de construire un homme nouveau, libéré de la mort, de l’histoire et de toute identité est la première menace à laquelle nous devons faire face, hommes de notre terre, de notre France, et qui savons dire « Nous ».
00:05 Publié dans Actualité, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grande séparation, hervé juvin, actualité, livre, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 17 décembre 2014
H. Juvin: La liquidation du monde pour fabriquer des richesses
Hervé Juvin:
"La fin du XXe siècle, c'est la liquidation du monde pour fabriquer de la richesse"
http://www.tvlibertes.com/
https://www.facebook.com/tvlibertes
https://twitter.com/tvlofficiel
Pour nous soutenir :
http://www.tvlibertes.com/don/
Ou directement via Facebook :
https://www.facebook.com/tvlibertes/a...
00:10 Publié dans Actualité, Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé juvin, actualité, entretien, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 12 juillet 2014
La fin de la mondialisation et le retour des identités...

La fin de la mondialisation et le retour des identités...
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Nous reproduisons ci-dessous un entretien avec Hervé Juvin, cueilli sur le site du Figaro et consacré à son dernier essai intitulé La Grande séparation - Pour une écologie des civilisations (Gallimard, 2013). Un ouvrage que nous ne pouvons que recommander à ceux qui ne l'ont pas encore lu !...
La fin de la mondialisation et le retour des identités
Figarovox: Votre livre s'intitule La grande séparation. Qu'est-ce que cette grande séparation? De quoi nous séparons nous?
Hervé Juvin : La condition politique repose sur la séparation des groupes humains qui assure leur diversité. Jusqu'ici cette séparation entre les hommes provenait de la langue, des mœurs, des lois et des cultures, et se traduisait par le phénomène universel de la frontière: on traçait des séparations matérielles entre «nous» et les «autres». Il s'agissait d'une séparation géographique, matérielle, et horizontale. La Nation était la traduction politique de cette séparation. Depuis une trentaine d'années, on assiste à un phénomène nouveau, une forme de transgression qui se traduit par le «tout est possible» ou «le monde est à nous». Tout cela est en train de faire naitre une nouvelle séparation qui bouleverse radicalement tout ce qui faisait le vivre-ensemble et le faire société. Ce que j'appelle «grande séparation», c'est cet espoir un peu fou, très largement dominant aux Etats-Unis, notamment à travers le transhumanisme, de s'affranchir totalement de la condition humaine. L'ultra-libéralisme, l'hypertrophie du capitalisme financier, le retour du scientisme sont l'une des faces d'un visage dont le transhumanisme, la transexualité, le transfrontiérisme sont l'autre face. Il faut en finir avec toutes les limites, toutes les déterminations de la nature. Ainsi Google a pour objectif affiché de lutter contre la mort à travers sa filiale Calico. L'idéologie transgenre veut que chaque homme et chaque femme puisse choisir leur sexe. Des entreprises très «humanistes» comme Goldman Sachs remboursent les opérations de changement de sexe de leurs employés!
Cette idéologie des «trans» vise à construire un homme hors-sol, délié de toute origine, et déterminé uniquement par sa propre volonté. C'est le retour du mythe de l'homme nouveau appuyé sur un délire scientiste qui voudrait que chacun soit à lui-même son petit Dieu autocréateur, pur produit de son désir, de ses intérêts ou de sa volonté propre. C'est cela, la grande séparation: la fabrique d'un homme sans origines, sans liens et sans foi, mais qui a chaque instant se choisit lui-même et choisit qui il est.
«Plus rien ne nous est étranger», tel est le résultat de la mondialisation. Pourtant à mesure que l'on cherche à détruire le même, l'autre revient toujours plus fort. L'uniformisation a pour conséquence un retour des particularismes. Comment expliquez-vous ce paradoxe?
On peut considérer qu'à bien des égards la mondialisation est achevée. J'ai la chance de voyager beaucoup dans le monde: il n'y a plus de jungles, de mangroves, de déserts, aussi perdus soient-ils où vous n'avez pas des gens qui sortent un téléphone portable de leur poche. La mondialisation des outils techniques - pour la plupart conçus en Occident- est à peu près aboutie. Le phénomène auquel on ne s'attendait pas, ce que j'appelle dans mon livre «l'aventure inattendue», c'est que l'uniformisation du monde est en train de réveiller les différences. L'exemple le plus frappant est celui de l'islam radical. Malraux parlait de «l'invincible sommeil de l'islam»: il y a trente ou quarante ans, l'islam était quelque chose d'endormi, d'immobile et d'assez pacifique. On peut dire ce qu'on veut sur les dérives extrémistes de l'islam, mais une chose est sûre: le retour (et dans certains cas l'invention) d'un fondamentalisme musulman (pratiques, cultes et doctrines rigoureux et agressifs) est généralement le produit direct d'une confrontation avec la modernité occidentale. Ceux qui vont combattre le djihad, en Syrie ou ailleurs, ceux qui ont commis des attentats en Occident, notamment le 11 septembre n'étaient pas des pauvres sans boulot ni éducation, mais des ingénieurs, des gens diplômés, parfaitement intégrés à la civilisation moderne. Il est intéressant de voir qu'une partie des mouvements fondamentalistes en Afrique - je pense notamment à Boko Haram- sont directement l'effet de l'agression de sociétés traditionnelles par les évangélistes et les missionnaires financés souvent par les fondations américaines. La mondialisation, dans laquelle on a voulu voir une homogénéisation du monde est en train de déboucher sur son contraire: le retour des particularismes identitaires, des singularités, et plus généralement un retour du «nous».
L'illusion du multiculturalisme du «village monde» a-t-elle vécu?
Depuis 40 ans on avait assisté à la proclamation de l'individu absolu, sans aucune appartenance, seul face au monde. On a aujourd'hui un retour de bâton de la réalité: on ne vit pas riche et seul dans un océan de ruines, on ne vit bien que quand on sent qu'on appartient à un ensemble, à un groupe, quand on est dans le faire-société avec d'autres, et c'est probablement ce que cette phase très déroutante de la mondialisation est en train de nous révéler.
Est-ce à dire que chacun va retourner chez soi et se confiner dans le séparatisme ethnique?
Quelle forme la séparation politique va-t-elle prendre en réaction à cette grande séparation? Difficile de le dire. Mais ce qu'il est important de comprendre c'est qu'on ne peut dire «nous» que lorsqu'on a déterminé qui sont les «autres». Il y a quelque chose de profondément mensonger et dangereux dans la grande séparation qui fait de tous les hommes sont les mêmes - les hommes réduits à l'idiot utile des économistes! Si tous les hommes sont les mêmes, je suis absolument isolé, seul et incapable de dire «nous». Dans la plupart des pays occidentaux, on assiste à cet isolement croissant des individus, qui n'ont plus de repères, plus de structures, plus de capacité à dire «nous». Pour dire «nous», il faut qu'il existe des «autres» qui ne sont pas appelés à devenir les mêmes. Nos amis américains disent volontiers: tout homme ou femme sur cette terre n'aspire qu'à une chose: devenir un américain comme les autres. C'est la négation absolue de l'altérité. C'est aussi l'inverse du respect pour l'Autre, celui qui ne sera jamais le même, celui qui à ce titre m'aide à sentir mon identité. La paix dans le monde repose sur l'idée inverse: indépendance et différence. j'ai trop longtemps vécu et travaillé à Madagascar, eu des amis marocains, fréquenté l'Inde, je respecte trop les Malgaches, les Marocains, les Indiens, pour vouloir qu'ils deviennent des Français comme les autres. Ils ont leurs identités, leurs coutumes religieuses, leurs mœurs, qui sont éminemment respectables: au nom de quoi puis-je dire que je suis supérieur à eux? Quel droit m'autorise à dire que l'avenir d'un malgache, d'un marocain ou d'un hindou est de devenir un Français comme moi?
C'est quelque part le crime de l'universel: de penser que ce qui est bon pour moi est bon pour le reste de l'humanité.
Oui, mais nier l'universel, n'est-ce pas nier le propre de la culture européenne?
C'est le grand débat des Lumières et de la prétention au règne universel de la raison. L'idée que nous, Occidentaux, Européens, Français, Américains, aurions mis en place depuis les Lumières un modèle idéal de vie pour l'humanité, entre la croissance économique et la révolution industrielle, la démocratie et les droits de l'homme. Je ne le crois absolument pas. Je crois que d'autres sociétés qui vivent avec d'autres lois, d'autres mœurs, selon d'autres règles, ont su offrir les conditions du bonheur à leurs habitants. Je ne souscris pas à l'idée selon laquelle notre régime politique, notre musique, notre art, notre culture seraient le point d'aboutissement de l'humanité vers lequel tous les autres peuples devraient converger. Il y a une voie chinoise, une voie hindoue, des voies africaines, qui feront des sociétés équilibrées et heureuses, sûres de leurs identités, différentes de la voie américaine ou de la voie européenne.
Toutes les civilisations se valent, alors? Il n'y a pas de valeurs transcendantes, pas de droits de l'homme, pas d'universel… L'excision et le mariage forcée des petites filles est de même valeur que la quasi égalité hommes-femmes en Occident?
On a le droit de défendre un système de valeurs qu'on croit universel. Vous n'allez pas me faire dire que je suis pour la lapidation! Personne évidement ne peut souhaiter être mis en détention sans jugements, être torturé, etc… Mais on ne peut pas ne pas constater les désastres que produit l'imposition par le haut du modèle occidental dans les sociétés traditionnelles. L'universalisme européen et américain n'a abouti qu'à des champs de ruines: en Afrique, en Afghanistan, en Irak, en Libye… Et la folle course en avant du développement menace la survie de l'humanité ; au nom de quoi arracher ces millions d'hommes qui vivaient hors de l'économie du capitalisme, de l'accumulation, dans un équilibre avec la nature, pour les précipiter dans un système qui détruit les biens vitaux et les services gratuits de la nature?
Les motifs humanitaires masquent souvent des ingérences guerrières. Le «droit au développement» masque l'agression impitoyable de l'obligation de se développer, qui a fait des ravages en Asie et en Afrique. Les limites à l'universel ne sont pas seulement morales, mais physiques. La pénétration sans limites d'internet répand dans des populations entières des rêves qu'elles n'auront aucun moyen de satisfaire, à moins de faire exploser la planète. Il est impossible que 9 milliards d'humains vivent comme un Américain moyen. Ne pas se rendre compte de cela, c'est créer les conditions d'une humanité frustrée. Non seulement cet universalisme sème les graines du malheur, mais il est contre-productif: plus il essaie de s'imposer, plus il réveille des particularismes de plus en plus agressifs.
C'est là un point essentiel en géopolitique aujourd'hui: l'agression des modèles universels réveille les logiques de la différence politique. Je cite dans mon livre celui que je considère comme le plus grand ethnologue du XXème siècle Elwin Verrier, pasteur britannique marié avec une fille de la tribu des Muria: au bout de quarante ans passés à côtoyer les tribus indiennes, il a abouti à la conclusion suivante: laissons les vivre comme ils sont, hors du développement économique. Mêlons-nous de ce qui nous regarde: sagesse qui nous éviterait bien des bêtises!
Hervé Juvin (Figarovox, 4 juillet 2014)
00:05 Publié dans Actualité, Entretiens, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé juvin, livre, entretien, philosophie, cultures, diversité culturelle, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 27 mai 2014
Un monde d'idées: Hervé Juvin
00:05 Publié dans Actualité, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé juvin, entretien, politique internationale, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 02 mars 2014
Dérapages européens
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, hervé juvin, politique internationale, suisse, référendum suisse |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 24 décembre 2013
H. Juvin: réponse au "Point"
00:02 Publié dans Actualité, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé juvin, néo-conservatisme, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 décembre 2013
Le plaidoyer pour la diversité d’Hervé Juvin

Identité, influence, puissance : face à la mondialisation, le plaidoyer pour la diversité d’Hervé Juvin
Dans l’entretien qu’il a accordé à Bruno Racouchot, directeur de Comes Communication, Hervé Juvin invite à penser le monde de l’après-mondialisation, du retour des singularités, des identités et des déterminations politiques. L’Europe et spécialement la France ont tous les atouts pour relever le défi. En particulier sur le registre du soft power et de l’influence. A condition toutefois de ne pas céder à la facilité, qui nous conduirait à renoncer à notre place dans le monde.
Bruno Racouchot (Directeur Comes Communication) : Dans votre dernier ouvrage, on voit que le processus de mondialisation exerce son pouvoir d’une part brutalement via les normes, la finance et le droit ; et d’autre part plus subrepticement via une pensée unique qui ne tolère pas la diversité des identités et des valeurs. Nous sommes donc bien là confrontés à un système de domination combinant hard et soft powers ?
Hervé Juvin : Permettez-moi de commencer par une anecdote historique rapportée par Alain Peyrefitte, qui tenait les minutes du conseil des ministres du général de Gaulle. Lorsqu’il organise son gouvernement, le général de Gaulle confie à Jean Foyer la charge de Garde des Sceaux. Il lui donne expressément la mission de respecter l’ordre suivant dans la hiérarchie des préoccupations : l’État d’abord, puis le droit. L’État et la nation ont primauté sur les formes et la conformité du juridique. Or, nous vivons aujourd’hui exactement l’inverse.
L’État apparaît comme le moyen de la mise en conformité du peuple et de la nation au regard de normes et de règles venues d’ailleurs. A la source de ce dysfonctionnement, il y a Bruxelles bien sûr, mais surtout Washington.
Car beaucoup de mesures qui entrent en application en Europe viennent directement de tel ou tel think tank, ONG ou relais d’influence américain. Ce qui dénote au passage un vide de la pensée et de l’analyse inquiétant sur le Vieux continent.
Si l’on fait ainsi l’histoire des mots comme “gouvernance”, “conformité juridique”, “création de valeur”, on observe qu’ils sont d’importation nord-américaine récente. On voit aussi que les “droits de l’homme” ne sont plus une proclamation généreuse, à caractère général sans conséquence légale concrète. Dans les faits, ils sont aujourd’hui devenus une arme politique et géopolitique de premier plan, qui peut être utilisée pour saper l’unité interne de n’importe quel pays et n’importe quel peuple.
Peu d’historiens et d’analystes politiques se sont essayés à décortiquer ce processus. A l’exception notoire de Marcel Gauchet qui publie en 1980, dans la revue Le Débat, un article de fond intitulé très clairement ” Les droits de l’homme ne sont pas une politique “, où il souligne notamment que “la conquête et l’élargissement des droits de chacun n’ont cessé d’alimenter l’aliénation de tous”. Marcel Gauchet persévère et signe en 2000, toujours dans les colonnes de la revue Le Débat , un autre article intitulé “Quand les droits de l’homme deviennent une politique”. Il n’apporte pas la réponse, mais je crois qu’en filigrane, nous pourrions deviner que ce soit une catastrophe !
En réalité, le système unique, c’est le rêve que tous les humains soient les mêmes partout dans le monde, sans que leur origine, leur sexe, leur croyance, leur langue, leur communauté politique puissent leur donner une identité. Ce qui justifie la remarque de René Girard, qui explique qu’à force de tolérer toutes les différences, on finit par n’en plus respecter aucune.
Je crains ainsi que sous couvert de l’éloge indiscriminé des différences individuelles, on soit en train de faire disparaître à grande échelle et très rapidement toutes les différences réelles, lesquelles sont par nature et donc nécessairement collectives.
Ces différences politiques, religieuses, de mœurs, de droit… sont ainsi visées directement par le rouleau compresseur de la mondialisation et son corollaire, à savoir la conformité aux droits individuels.
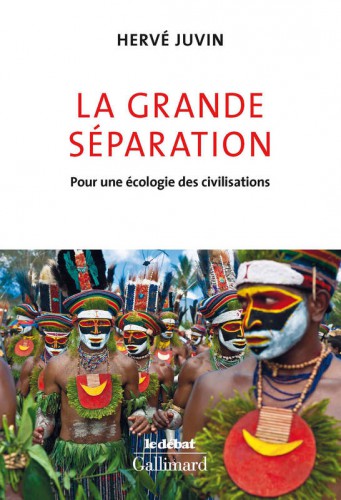
BR : Pour ce qui est de combattre ce soft power de la pensée unique à l’échelle mondiale, quelles stratégies de contre-influence imaginer et sur quel socle les faire reposer ?
HJ : Il nous faut ouvrir les yeux et travailler. Nous devons nous mettre d’urgence aux outils et à la logique du soft power. Je suis frappé du fait qu’en Chine, aux États-Unis, en Russie et dans bien d’autres pays émergents, on travaille sérieusement cette question. Un exemple : la floraison de think tanks et d’ONG anglo-américaines a permis que de nouveaux concepts soient acceptés comme vérités d’Évangile, en France, en Europe ou ailleurs, à notre plus grande défaveur. C’est la construction de dispositifs intellectuels, d’outils de diffusion et de promotion, qui favorise cette puissance discrète.
De même, le repérage de jeunes talents ou de personnages ayant une audience fait partie du jeu. Voyez comment certains diplomates américains travaillent avec les minorités visibles des banlieues françaises. Ces jeunes sont assez vite conviés à venir à Washington pour participer à des travaux, et entrent ainsi dans une spirale d’influence. Il y a donc travail à plusieurs niveaux : organisation, déploiement de moyens, recherche d’incitations productives, puis montée en puissance et synergie. Chinois, Russes, Américains, Israéliens… ont tous une conscience aiguë que les distinctions entre public et privé s’effacent quand l’intérêt national est en jeu. Encore plus quand il s’agit d’un enjeu de survie.
Le libre-échange, l’égalité entre les peuples, et autres thèmes en vogue sont en fait des doctrines à vocation d’exportation, de la part d’entités politiques qui se conçoivent comme des puissances en lutte. Or dans cette lutte, tous les outils – commerciaux, juridiques, intellectuels, militaires, etc. – doivent être employés au service de l’intérêt national.
Prenez l’exemple des sociétés les plus créatives, les plus échevelées et innovantes, comme le sont les sociétés américaines de la sphère internet : elles travaillent main dans la main avec les agences de renseignement des États-Unis ! Nous sommes là aux antipodes de notre praxis politique actuelle, bien française, qui veut qu’il y ait une frontière bien marquée entre sphère publique et sphère privée. Nous ne parlons malheureusement pas en France en termes d’intérêt national. On s’interdit de travailler main dans la main entre public et privé alors que l’intérêt national l’exigerait. A cet égard, les dogmes de la Commission de Bruxelles – par exemple en matière de concurrence – nous font énormément de mal et surtout nous bloquent dans l’expression de notre puissance.
BR : Le concept d’identité se trouve au cœur de la démarche développée depuis quinze ans par Comes Communication. Selon vous, la mise en valeur de son identité par une entreprise ne constitue-t-elle pas un puissant facteur différenciant, donc un avantage concurrentiel ? En ce sens, l’identité, qui permet d’affirmer sa spécificité et son authenticité, ne s’impose-t-elle pas comme un facteur de performance, générant de la création de valeur, pour les entreprises comme pour d’ailleurs toute organisation ?
HJ : En matière d’identité, ce qui a fait durant des siècles l’autorité et l’écoute du discours français, c’est d’abord son autonomie, faisant de nous un pays non-aligné pas vraiment comme les autres. Notre parole n’était pas celle d’une superpuissance, mais celle d’une puissance phare en matière d’intelligence et de liberté. Si l’on devait refaire aujourd’hui une conférence de Bandung [NDLR : conférence des non-alignés en 1955], la France y aurait pleinement sa place, aux côtés de ceux qui entendent conserver leur identité et leurs singularités. Là réside sans doute le grand champ géopolitique de demain.
De même, ce qui vaut pour la sphère politique vaut aussi pour les sociétés privées. Depuis une trentaine d’années, ces dernières développent des stratégies essentiellement guidées par des critères financiers. Or les stratégies ainsi définies s’arrêtent à la surface des choses. Parce qu’à mon sens, les entreprises qui seront gagnantes sur le long terme seront celles qui auront su développer, en interne comme en externe, une identité propre, autrement dit une singularité les distinguant de leurs concurrents et de leur environnement.
Cette identité assure leur pérennité dans le temps car elle est transmissible. On observe d’ailleurs que la définition de cette identité d’entreprise est fréquemment liée à la personnalité d’un dirigeant, qui marque souvent plus par l’implicite que par l’explicite.
L’identité n’est ni une succession de powerpoints, ni une logique de ratios. L’identité ne se laisse jamais mettre en équation ni cerner par les chiffres. Une entreprise qui se réduit à des chiffres se réduit assez vite à rien. Si elle veut agir dans la durée, et favoriser la création de valeur ajoutée, la résilience, la capacité de mobilisation des équipes, l’entreprise doit s’efforcer de jouer sur son identité bien plus que sur le socle fallacieux des chiffres.
BR : Sur le plan géostratégique et géoéconomique, le recours aux liens identitaires constitue à vos yeux un moyen idoine pour enrayer la montée en puissance à l’échelle planétaire de l’individu-déraciné-et-consommateur que prône la mondialisation. Le rôle-clé de l’identité, son action, son rôle s’appliquent-ils de la même façon aux individus, aux peuples, aux États ? Comment l’identité s’intègre-t-elle dans les rapports de force économiques, politiques, sociaux, culturels… ?
HJ : Si l’on se place dans une perspective historique, il apparaît que l’identité est clé dans tous les processus de résilience ainsi que dans la performance stratégique. On a usé et abusé de la formule de Sénèque, selon laquelle il n’est pas de vent favorable à celui qui ne sait où aller. Je serais tenté de dire qu’il n’y a pas de vent favorable non plus pour celui qui non seulement ne sait pas qui il est, mais en outre, ignore qui l’accompagne sur le bateau.
La capacité à affirmer une identité va de plus en plus s’imposer comme un élément-clé dans les années à venir.
L’idée américaine selon laquelle on doit fermer les yeux sur les questions de sexe, de religion, de culture, d’appartenance à une communauté, aboutit à nier même la notion même de singularité des hommes et des organisations. Or, ce sont justement ces singularités ne se réduisant pas à une valeur monétaire qui vont compter dans les années à venir.
Les entreprises qui se laisseront prendre au piège de l’indifférenciation et de la mondialisation, passeront à côté de cette question-clé de l’identité. L’entreprise sans usine, qui externalise tout, qui sous-traite au point de perdre la maîtrise de ses métiers de base, se trouve en fait réduite à rien, dépassée et dévorée. Prenons l’exemple d’une chaîne de supermarchés : ce sont d’abord des épiciers, avec l’alliance subtile de leurs défauts et leurs qualités, qui in fine produit leur identité. Ce ne sont pas des comptables ou des financiers qui en sont les artisans. Nous avons donc bien là affaire à des logiques intimes, clairement différentes.
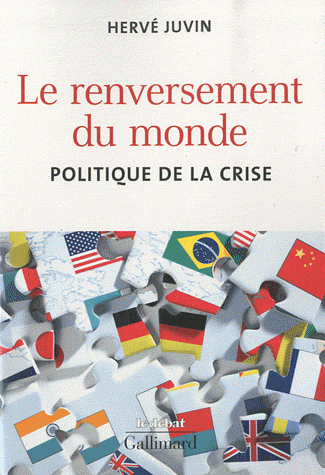 BR : Vous écrivez dans votre dernier livre : “La décomposition des nations européennes procède de la censure, de la grande fatigue devant l’histoire et de leur soumission par en haut aux institutions internationales, par en bas aux communautés et minorités revendicatrices.” Comment les peuples peuvent-ils espérer agir pour renouer avec cette énergie vitale et cette confiance en eux qui leur permettront d’affronter les défis à venir ?
BR : Vous écrivez dans votre dernier livre : “La décomposition des nations européennes procède de la censure, de la grande fatigue devant l’histoire et de leur soumission par en haut aux institutions internationales, par en bas aux communautés et minorités revendicatrices.” Comment les peuples peuvent-ils espérer agir pour renouer avec cette énergie vitale et cette confiance en eux qui leur permettront d’affronter les défis à venir ?
HJ : Nous sortons d’une période de prospérité dont nous n’avons pas eu clairement conscience. En France et en Europe, l’immense majorité de la population vit bien. Au regard de l’histoire de l’humanité, je dirai même que ce constat constitue une exception : pacification des territoires, niveau de vie, santé, etc. nous avons prospéré durant ces dernières décennies sur un mode extrêmement privilégié.
Le retour au réel risque d’être quelque peu brutal. Nous allons devoir nous confronter de nouveau aux dures réalités géopolitiques.Le facteur déclenchant sera probablement l’explosion de la classe moyenne. La lucidité politique va s’imposer rapidement à nous.
En outre, l’idée béate dans laquelle se complaît l’Europe, selon laquelle tous les problèmes de ressources sont liés aux marchés et aux prix, va trouver de fait ses limites. Nous allons très vite basculer sur des logiques de survie, n’ayant plus rien à voir avec une approche rationnelle. Et probablement assister demain, avec la question de l’eau, des terres rares ou des terres arables, à des défis semblables à ceux du pétrole hier. Le pétrole est un objet géopolitique, bien avant d’être l’objet du marché. Par la force des choses, nous allons donc être ramenés aux réalités des enjeux géopolitiques. Et notre survie va exiger que soit dès lors prioritairement prise en compte la notion d’intérêt national.
Ne nous leurrons pas : la question de notre survie politique se trouve bel et bien posée. Est-ce que quelque chose qui s’appellera encore la France existera en 2050 ? L’Union européenne existera-t-elle en 2020 ? Pour ma part, ce qui m’inquiète, c’est que nos élites et nos dirigeants ne me paraissent pas formés pour faire face à ces défis. Ces gens ont toujours œuvré dans un monde de continuité. La question était : va-t-on faire +3% ou + 5 % de croissance ?… Oui, nous entrons dans un monde avec des perspectives radicalement différentes. Ce qui veut dire que notre mindset, notre disposition d’esprit, notre logiciel de pensée, et donc toutes nos approches stratégiques, doivent être revus de fond en comble.
C’est là, me semble-t-il, le vrai défi d’actualité pour la pensée française. À savoir la capacité à penser le monde de l’après-mondialisation, du retour des singularités, des identités et des déterminations politiques. Je crois que nous avons tous les atouts pour cela. À condition toutefois de ne pas céder à la paresse ou à la facilité intellectuelle, qui nous conduisent à renoncer et à perdre notre place dans le monde. Ne nous y trompons pas : au-delà des rodomontades et des stupidités de notre politique étrangère – qui jouent assez peu, en fait, sur le long terme – c’est la capacité de la France à être un émetteur d’idées, un diffuseur de pensée, avec une réelle autorité et une authentique aptitude créatrice, qui compte. Mais prenons garde à ce que ces atouts ne soient pas en train de s’épuiser…
00:05 Publié dans Actualité, Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé juvin, philosophie, différentialisme, entretien, diversité, pluralité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 15 décembre 2010
Vers un Big Bang géopolitique - Entretien avec H. Juvin
Vers un Big Bang géopolitique
Entretien avec Hervé Juvin
Ex: http://blogchocdumois.hautetfort.com/ Hervé Juvin n’est pas qu’un économiste, ni uniquement un essayiste, non plus seulement le président d’Eurogroup Institute, il est encore et surtout un analyste incomparable, aussi lucide que courageux, du monde comme il ne va plus.
Hervé Juvin n’est pas qu’un économiste, ni uniquement un essayiste, non plus seulement le président d’Eurogroup Institute, il est encore et surtout un analyste incomparable, aussi lucide que courageux, du monde comme il ne va plus.
La crise – économique, systémique, anthropologique – que traverse l’Occident, ou plutôt les Occidents disloqués, a trouvé en lui l’un de ses interprètes les plus perspicaces. Il vient de publier chez Gallimard un essai sur « le renversement du monde », ce monde sur lequel on vivait et qui se retrouve la tête en bas. Décapant. Et très éclairant.
Le Choc du mois : Ce que vous appelez le « renversement du monde » tient d’abord selon vous à une sorte de pathologie de l’Occident qui serait devenu incapable de penser les dimensions du politique et de l’identité…
Hervé Juvin : Je ne suis pas sûr qu’il n’y ait pas, au lieu d’un Occident, plutôt des Occidents, au pluriel, et de plus en plus. L’intervention américaine dans l’ex-Yougoslavie, pour ne citer qu’elle, est un moment où l’Occident s’est sans aucun doute battu contre lui-même. On peut en dire autant de la crise financière, qui a vu l’opposition anglo-américaine contre l’Europe s’exacerber. En fait, il faut revenir à ce moment particulier, non pas tant de la chute du mur de Berlin que de la dissolution de l’Empire soviétique, dont on oublie toujours de rappeler à quel point elle fut éminemment et très curieusement pacifique. De là va résulter un mouvement d’euphorie qui traversera quasiment tout l’ensemble occidental et dont l’expression emblématique restera le livre de Fukuyama, La fin de l’Histoire et le dernier homme. Trois raisons à cela : d’abord, l’on assistait à la fin du colonialisme ; ensuite, l’on voyait l’explosion du bloc qui incarnait non seulement le Mal, mais encore plus sûrement l’Autre absolu ; enfin, l’on pouvait estimer que la démocratie était en train de s’universaliser. Autant de raisons qui nous ont poussés à croire qu’il était possible de s’abstraire de la condition politique. Or, la condition politique, c’est essentiellement deux choses : le fait qu’il y a des hommes, et non pas l’Homme avec un grand H, comme le remarque si bien Hannah Arendt ; et le fait qu’il y a des frontières, à l’intérieur desquelles les hommes exercent la liberté de s’autodéterminer, dans le cadre d’une nation, à travers un État souverain et un territoire national clos.
Autrement dit, les Mêmes décident de ce qui concerne les Mêmes : les décisions que prend le peuple français n’engagent que les seuls Français, du présent et des générations à venir, pas les Américains, les Russes, les Marocains, etc. Or, on assiste pendant plus d’une décennie à la mise en apesanteur de cette condition politique. Comme les frontières vont disparaître et la démocratie planétaire s’étendre partout, il n’y aura plus que des individus, tous voués à la poursuite du bonheur, tous habités par un désir illimité. Dès lors, le seul principe de régulation des individus sera l’économie ou le marché, bref ce phénomène extrêmement important que l’on va désigner sous le nom de globalisation.
Vous expliquez également que cette globalisation repose sur une alliance objective entre l’ État et le marché. Quelle forme a-t-elle prise ?
Dans les années 1990, nous sommes entrés, sur le plan politique, en territoire inconnu, par suite de la diffusion des Droits de l’Homme, perçus comme un droit illimité de l’individu à se départir de tout collectif, à briser tout lien, à nier toute appartenance, à se désengager de tout rapport durable et pérenne avec les siens. De défensifs, le sans-frontiérisme et le mondialisme sont ainsi devenus agressifs. Parler de nationalités, de frontières et de souveraineté vous faisait passer pour démodé et vieux jeu, sinon carrément indécent. Le Droit et le Marché prétendaient alors se substituer au Politique dans une conjuration tout à fait étonnante qui devait déboucher sur une libération de l’individu et même du collectif, toutes deux éminemment bénéfiques. Le phénomène a été abondamment commenté, notamment par les penseurs socialistes issus de l’extrême gauche dans les termes les plus enthousiastes. Ce sont les grands mots de «société citoyenne» ou «société civile», lesquelles viendraient reprendre leurs droits.
Il n’en fut rien. Ce à quoi on va assister, c’est au contraire à l’apparition d’une configuration tout à fait inédite, mise en évidence par la crise, dans laquelle, comme Marx et Nietzsche l’avaient bien vu dès la fin du xixe siècle, l’ État ne va plus se définir que contre le peuple, et même contre les peuples, parce qu’il devient l’infrastructure de déploiement du marché, du libre-échange, de la circulation indéfinie des capitaux, des biens et des personnes. La grande entreprise entreprend de changer les peuples, organisant l’invasion et le démantèlement des Nations, avec le concours d’ États tenus par des engagements arrachés par Bruxelles sous l’influence anglo-américaine. C’en est fini du principe majoritaire, du suffrage universel et de la démocratie représentative. Le paradoxe, c’est que tout cela va se faire sous l’égide du Droit, alors qu’on assiste au retour des principes constitutifs de la Colonisation. Car si l’on veut bien poser un regard un peu décapant et inhabituel sur la situation actuelle, il faut revenir à la conférence de Bandung, en 1955, réunion d’ États asiatiques et africains qui annonce la fin de la période coloniale et l’avènement d’un nouvel ordre du monde. A cinquante ans de distance, il ne fait aucun doute que l’appel de Bandung a été entendu, puisque la décolonisation politique a été effective. Mais il est tout aussi évident que l’on a assisté parallèlement à une colonisation interne des sociétés humaines par la finance de marché et l’économie. De façon inattendue, violente, avec une rapidité ravageuse, l’économie a pris le pouvoir. Cela uniquement parce que les États ont mis à la disposition du marché leurs infrastructures, dont celles relevant de la sécurité, de la censure et du contrôle des populations. Telle est la configuration que la crise a révélée. J’en veux pour preuve la promptitude avec laquelle les États ont volé au secours d’établissements financiers et de sociétés d’assurance en situation de faillite (et qui auraient mérité d’être faillis), en mobilisant avec une rapidité impressionnante toutes leurs ressources, qui sont en dernier ressort celles du contribuable.
La globalisation occidentale serait donc la fille des colonialismes européens ?
Le colonialisme du xixe siècle, c’était déjà le rêve d’un monde sans limites, d’une nature inépuisable, et plus encore l’idée que le monde s’offrait aux colons blancs pour en user à leur guise parce qu’ils étaient les détenteurs de la civilisation, de la morale et du Bien. On oublie d’ailleurs toujours de rappeler que quelques-uns des plus éminents dirigeants socialistes de la IIIe République furent les plus ardents colonisateurs. Mais les colonialismes européens étaient nationaux, plus que religieux ou financiers. C’était la France, l’Allemagne, l’Angleterre, qui plantaient leurs drapeaux. Aujourd’hui, le régime des colons se déploie sous l’influence américaine, et, dorénavant, chinoise. Si le modèle américain, c’est certes celui de la première libération d’un peuple du colon britannique, c’est aussi celui d’un développement par l’éradication des indigènes. Le génocide indien libère la terre pour l’exploitation infinie du colon.
Nous assistons aujourd’hui à l’extension mondiale de ce système. Le droit du colon, c’est-à-dire celui du développeur et de l’investisseur capable de rentabiliser n’importe quel actif, est jugé supérieur à celui de peuples autochtones et indigènes à demeurer sur leur sol, selon leurs mœurs, lois et règles.
Le droit au développement masque l’obligation de se développer… ou de partir. Contre l’économie, nul ne saurait se dresser légitimement. C’est exactement ce principe qui préside à la colonisation interne de nos sociétés, par exemple à l’obligation d’accepter l’immigration de peuplement.
Pour le dire très clairement, le principe de la colonisation étendue à la totalité du monde est en train de recréer un vaste marché de l’esclavage, en contraignant toutes les ressources terrestres à fonctionner dans le système économique à un prix de marché jugé universel. Ce qui constitue la négation absolue du droit des autochtones à disposer d’eux-mêmes. L’événement nouveau et renversant, c’est que nous, Européens, sommes en train de subir le même phénomène d’humiliation, d’expulsion et d’invasion, qu’enduraient jadis les colonisés. Interdits d’identité, bafoués dans nos mœurs et lois, privés de nos mots et expressions, au nom d’une conformité sur laquelle veillent les chiens de garde de la nouvelle Internationale, nous nous rapprochons insensiblement, mais rapidement, de la condition des indigènes si bien décrite par Claude Lévi-Strauss. A quand des réserves pour les Français de souche ? La lutte pour la décolonisation interne de nos sociétés sera le sujet politique de la génération à venir. Ce sera l’occasion d’affirmer une nouvelle radicalité républicaine, l’occasion aussi de réaliser l’union de tous les peuples contre l’entreprise mondialisée et la finance satellisée.
Pensez-vous que la survie même des nations occidentales soit engagée dans ce processus néo-colonial ?
Après 1990, se sont développés un discours et une idéologie abrités sous le double biais du libre-échange, garant de la croissance et de la stabilité des prix, et de la liberté de mouvement des hommes, garante de la paix dans le monde comme du droit de chacun à poursuivre son bonheur privé. Il s’agissait clairement d’une idéologie de la disparition des nations. On voit aujourd’hui avec quelle naïveté l’Union européenne l’a endossée, estimant que la poursuite de la construction européenne ne pouvait se faire qu’en défaisant le national. Une telle politique comportait un risque considérable : en détricotant les nations, on réveillait le démon des origines, celui des religions, mais aussi des régionalismes qui sont en train de gagner toute l’Europe. Aveugles aux conséquences de la mondialisation – déracinement, désaffiliation, désappartenance –, nous n’avons pas voulu voir la violence qu’elle ne manquerait pas de semer dans le monde. Or, l’on sait – ou l’on devrait savoir – que rien n’est plus capable de violence, et d’une violence illimitée, qu’un homme seul, réduit aux émotions et aux passions, privé de liens, d’attachements et, souvent, de convictions. Ce modèle de « l’homme sans qualités », de l’homme-bulle, de l’homme en apesanteur, est le produit de la société de marché et l’idéal de la démocratie planétaire. A nier la condition politique, nous avons pensé que l’individu absolu était l’homme du futur, alors qu’un tel individu, non seulement, n’existe pas, mais peut s’avérer être un monstre capable de tout. Ce que nous commençons à entrapercevoir, ici ou là, dramatiquement. La mondialisation a donc sécrété une extrême violence. En sortir appellera en retour une violence identique. En clair, nous sommes partis pour une phase qui va répondre, au moins à moyen terme, à la brutalité de la mondialisation, sur fond de retour des questions de frontières, d’identités de souveraineté, de légitimité, lesquelles vont laisser muette une large partie de la classe politico-intellectuelle, qui, depuis une génération au moins, a désappris à penser la politique. Le temps de la décolonisation interne de nos sociétés est venu.
A vos yeux, les chefs d’ État occidentaux sont donc directement responsables de la crise que le monde traverse depuis trois ans ?
La crise a d’abord été une crise du sans-limite. Il est clair que lorsque des entreprises, qui se disent privées et n’apportent de l’argent qu’à leurs seuls actionnaires, tout en faisant jouer un effet de levier sur le collectif – État et contribuable –, parce qu’elles sont, selon l’expression consacrée, « trop grosses pour mourir », c’est qu’elles ont au préalable trop grossi. Cet effet de levier sur la collectivité n’est pas tolérable.
Seconde faute majeure, celle de l’interdépendance. La crise a été manifestement une crise de l’interdépendance. Or, si nous avons été sauvés, c’est par des pays dont la monnaie n’est pas convertible et qui se sont protégés des excès des mouvements de capitaux et de l’économie de marché. En somme, nous avons été sauvés parce que l’interdépendance n’est pas planétaire. Mais quels sont les conseils prodigués, au terme de la série des G20 suscitée par l’Occident, pour sortir de la crise ? Accroître l’interdépendance (on le voit avec la pression exercée sur la Chine et l’air pincé des institutions mondiales à l’encontre de pays comme l’Inde ou le Brésil qui refusent l’afflux de capitaux spéculatifs). C’est donc aussi une crise de l’absence de responsabilité. Ceux qui, par cupidité et refus de tout lien avec une communauté ou une collectivité quelconques, en ont été à l’origine ne veulent endosser aucune responsabilité, et même pour la plupart, ne seront tout simplement pas remis en cause. Les Américains n’ont-ils pas l’insolence de faire la leçon au monde ? On voit pourtant bien que le règne de la conformité à la norme et à la règle ne résout rien, tant il est vrai que la responsabilité ne s’exerce que devant une communauté ou une collectivité définies, la responsabilité planétaire n’existant pas. Mais encore une fois, ce qui a triomphé, c’est le principe du renard libre dans un poulailler libre.
Ce qui me conduit à ce constat quelque peu désolant : tout indique que nous sommes dans un système de crise. La crise, c’est ce que l’on a inventé de mieux pour casser les systèmes de protection sociale en Europe, pour étendre le règne du marché et pour liquider tout ce qui dans les sociétés humaines et les peuples constitués n’entendait pas s’abandonner à l’interdépendance et à la loi du marché mondial. Voilà où nous en sommes : tout faire pour que rien ne change, tel est le credo inentamé de l’Occident. Mais ajouter des liquidités à une mer de liquidités pour éviter la déflation, réclamer plus d’interdépendance pour faire financer le naufrage américain et occidental par ceux qui ont préservé jusqu’ici leur autonomie, tout cela ne pourra pas fonctionner. Le sauvetage du système peut faire illusion un moment, mais il ne fera que rendre la crise encore plus grave, par renforcement des illusions du libre-échangisme, du mondialisme et du sans-frontiérisme. Alors que ce à quoi devraient travailler les décideurs et responsables, c’est précisément de préparer l’après.
Ce que naturellement ils ne font pas ?
Parce qu’il s’agit avant tout de parer au plus pressé, parce que l’ensemble des cadres intellectuels mis en place depuis plus d’une trentaine d’années sont devenus totalement obsolètes. Nous devons nous habituer à la fin de l’universel, réapprendre que la condition humaine ne se réduit pas à l’existence d’un homme-bulle en apesanteur, redécouvrir les identités, les frontières, les nations, les religions, les passions politiques. Bref, nous devons rouvrir les yeux sur le monde. Or, en Europe et aux États-Unis, on semble persuadé que les autres sont destinés à devenir pareils à nous. Ce qui nous épargne d’avoir à nous y intéresser. Nous avons jadis conquis le globe parce que nous avons été extraordinairement riches en mondes, capables de nous intéresser à l’Autre, d’essayer de le comprendre, infiniment curieux, observateurs et ouverts. Mais voilà, nous sommes devenus pauvres en mondes. Nous ne voyons pas la manière dont le monde se renverse. C’est probablement le plus grand sujet d’inquiétude pour les années à venir. J’invite tous les dirigeants à partir à la redécouverte du monde. C’est la tâche la plus essentielle aujourd’hui. Il faut se départir de cet immense mensonge, quasiment criminel, selon lequel le monde serait devenu plat. Le monde n’est plat que pour ceux qui vont d’aéroports en Hilton et d’Hilton en aéroports. Nous sommes aveugles à l’impressionnante montée de l’Islam, facteur géopolitique aussi important que l’avènement de la Chine ; aveugles au contrôle d’Internet par les États-Unis ; aveugles au discrédit du soft-power occidental, résultat du « deux poids, deux mesures » appliqué dans le domaine nucléaire aussi bien que dans les agressions américaines contre l’Irak et l’Afghanistan ; aveugles aux renaissances politiques que provoquent les agressions des fonds d’investissement sur les terres agricoles ; aveugles aux effets de la diffusion planétaire des technologies de communication.
Propos recueillis par Philippe Marsay
Hervé Juvin, Le renversement du monde, Politique de la crise,
« Le Débat », Gallimard, 261 p., 17,90 €.
00:30 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, hervé juvin, livre, entretiens, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


